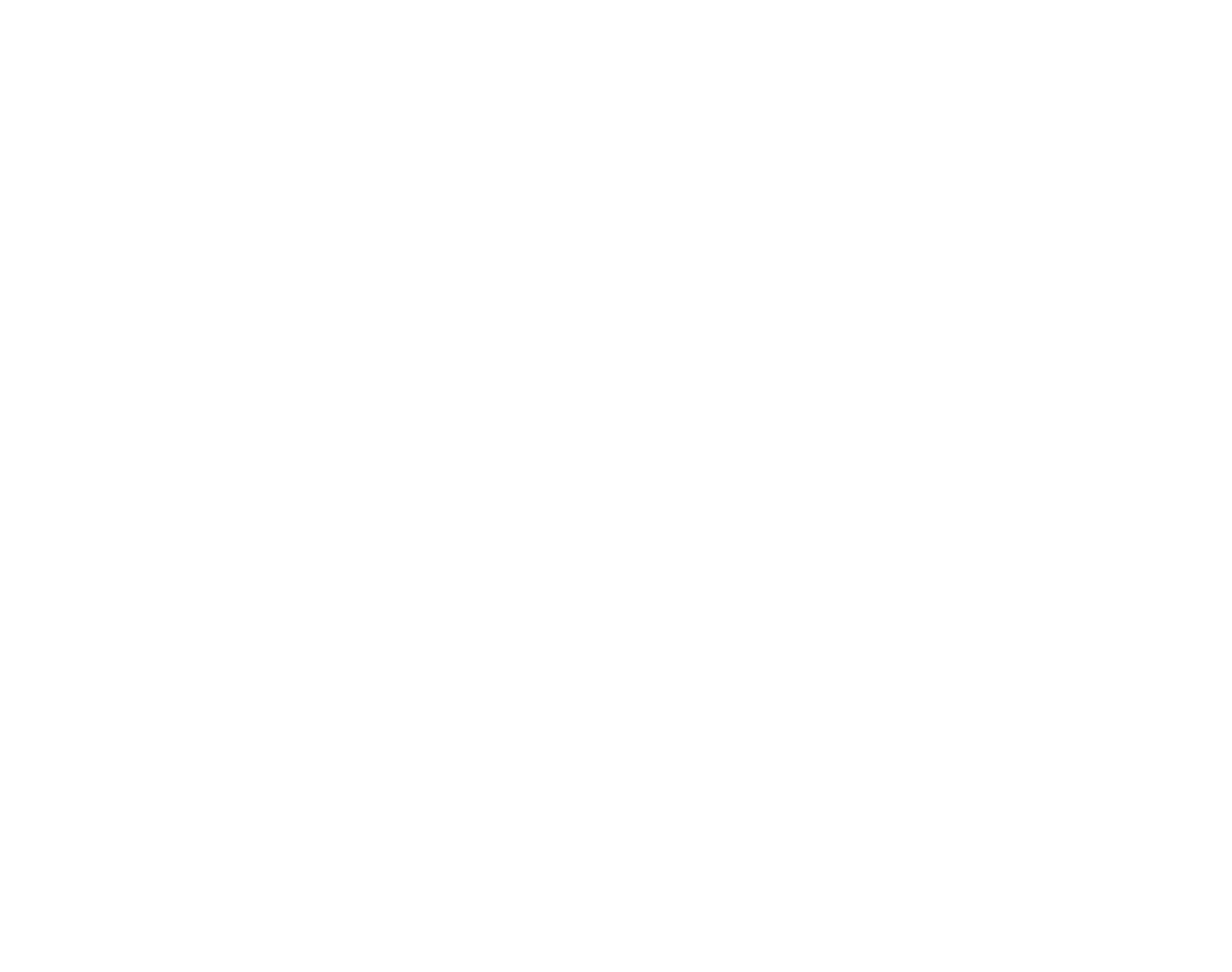Politique, droite, gauche, conflit israélo-palestinien et Charlie Kirk (Luc Vandestraten)
Clivages, vérités et réalités : remettre les choses au clair
Quand on parle de politique aujourd’hui, surtout dans le contexte du conflit israélo-palestinien, on voit clairement deux camps se dessiner. La droite et la gauche ne se distinguent pas seulement par des choix économiques ou sociaux, mais par une vision fondamentale de ce qu’est le bien et le mal, de ce qu’on accepte et de ce qu’on condamne.
La droite, dans sa ligne générale, part d’un principe simple : le terrorisme ne se justifie jamais. Un mouvement qui prend en otage des civils, qui massacre sans distinction, qui utilise la peur comme arme politique, ne peut être ni excusé ni reconnu. Reconnaître un tel mouvement comme un “État” revient à légitimer sa méthode, et donc à encourager le terrorisme dans le monde entier. C’est pourquoi la droite se situe du côté d’Israël : non pas par “aveuglement idéologique”, mais par cohérence avec un principe clair — défendre le droit d’un pays à exister et à se défendre contre ceux qui veulent l’anéantir.
La gauche, de son côté, se perd souvent dans un discours de victimisation et d’idéalisme creux. Sous prétexte de “justice sociale” ou de “défense des opprimés”, elle en vient à fermer les yeux sur la nature réelle de certains groupes armés. Au lieu de sanctionner, elle veut “reconnaître”. Au lieu de condamner, elle “comprend”. Résultat : elle offre une récompense politique au terrorisme, comme si massacrer des innocents pouvait être une étape légitime vers la reconnaissance internationale. C’est non seulement une faute morale, mais aussi un encouragement à la répétition de ces crimes.
Vu mon amour pour Israël, le peuple élu, et ma foi dans le Dieu d’Israël, le Dieu de la Bible, je crois profondément que cette nation a une place centrale dans l’histoire et dans le monde, tant sur le plan spirituel que divin. Ce peuple occupe une place fondamentale à tous les niveaux. D’ailleurs, il suffit de regarder l’actualité pour se rendre compte que l’on parle sans cesse de la nation d’Israël. Dans ce contexte, et au vu des tendances actuelles — où la droite tend à soutenir ce peuple tandis que la gauche a tendance à victimiser les Palestiniens et à fustiger Israël au lieu de combattre le Hamas — la droite, telle qu’elle se présente aujourd’hui, semble plus teintée de bon sens et orientée vers un raisonnement logique, notamment sur des questions comme le conflit israélo-palestinien et les prises de position de figures comme Charlie Kirk. Quand j'observe le paysage politique global, la droite actuelle semble plus en accord avec mes convictions, notamment mes valeurs chrétiennes.
Contexte et origines du conflit israélo-palestinien
Le conflit israélo-palestinien trouve ses racines dans la légitimité biblique et l’histoire moderne.
Selon le récit biblique, dans l’Ancien Testament, Dieu promet à Abraham un peuple et une terre : « Je ferai de toi une grande nation et je te donnerai ce pays pour héritage » (Genèse 12:2-3). Cette promesse s’inscrit dans la continuité d’un lien spirituel et historique unique entre le peuple juif et la terre d’Israël, une légitimité qui ne se réduit pas à une simple possession territoriale, mais qui fonde l’identité et la vocation du peuple juif.
À cela s’ajoute une mémoire historique marquée par l’une des tragédies les plus profondes de l’histoire humaine : la Shoah. Entre 1939 et 1945, six millions de Juifs sur dix-huit millions ont été systématiquement exterminés par le régime nazi. Cette destruction planifiée, massive et ciblée a décimé un tiers du peuple juif et a constitué un traumatisme central. Il ne faut pas penser que la Shoah a été à l’origine de la volonté d’établir un foyer national juif : cette idée existait déjà depuis la Déclaration Balfour de 1917. Cependant, le traumatisme engendré par la Shoah a accéléré et concrétisé le processus, renforçant l’urgence pour le peuple juif d’avoir un État sûr et souverain.
Sur le plan politique moderne :
1917 – Déclaration Balfour : Le Royaume-Uni soutient la création d’un « foyer national juif » en Palestine.
1947 – Plan de partage de l’ONU : La Palestine est divisée en deux États, un juif et un arabe ; les Juifs acceptent, les Arabes refusent.
1948 – Création de l’État d’Israël : Israël proclame son indépendance. Les armées arabes attaquent, mais Israël gagne et sécurise son territoire. Des centaines de milliers de Palestiniens fuient ou sont expulsés.
1967 – Guerre des Six Jours : Israël repousse les attaques des pays arabes voisins et prend le contrôle de territoires supplémentaires (Cisjordanie, Gaza, Golan).
En 2005, Israël se retire unilatéralement de la bande de Gaza, espérant réduire les tensions et favoriser la paix. Cependant, cette sortie est suivie, en 2006, par l’élection du Hamas au pouvoir à Gaza, un groupe terroriste qui refuse de reconnaître l’État d’Israël et multiplie les attaques contre les civils israéliens.
Le 7 octobre 2023, le Hamas lance une attaque massive et coordonnée contre Israël depuis Gaza, tuant et capturant des centaines de civils. Cette attaque illustre la dangerosité du Hamas et la nécessité pour Israël de se défendre.
Israël défend donc sa souveraineté face aux agressions et aux attaques terroristes, tandis que le Hamas refuse toujours l’existence de l’État juif. La combinaison de légitimité biblique, de mémoire historique tragique et de réalités géopolitiques explique pourquoi le conflit reste si intense et persistant.
Ce qu'il faut savoir aussi :
Depuis sa création, Israël a à plusieurs reprises accepté des propositions de paix visant une solution à deux États. Dès 1947, le plan de partage de l’ONU prévoyait la création d’un État juif et d’un État arabe sur la Palestine mandataire, avec Jérusalem sous administration internationale. La communauté juive l’a accepté, mais les pays arabes environnants et les dirigeants palestiniens l’ont rejeté, déclenchant la guerre de 1948. Par la suite, Israël a continué de chercher la paix, proposant des compromis sur les frontières et des échanges de territoires, mais ces initiatives ont été refusées par les pays arabes.
Les tentatives les plus marquantes :
2000 – Camp David : Israël propose un État palestinien sur une grande partie de la Cisjordanie et de Gaza, avec un partage de Jérusalem et des solutions limitées pour les réfugiés. Yasser Arafat et l’Autorité palestinienne refusent.
2003 – Feuille de route du Quartet : Proposition d’un État palestinien progressif, sous conditions de désarmement et de reconnaissance d’Israël. Israël accepte partiellement, mais les Palestiniens rejettent plusieurs étapes.
2008 – Offre d’Olmert : Israël offre plus de 90 % de la Cisjordanie, des échanges de territoires et un partage de Jérusalem. Mahmoud Abbas refuse, jugeant ces concessions insuffisantes.
À chaque étape, le schéma reste le même : Israël a cherché des compromis pour permettre la coexistence de deux États, mais ces propositions ont été rejetées par les dirigeants palestiniens ou les pays arabes, empêchant ainsi la concrétisation d’une solution négociée et durable.
Pourquoi il n’y a pas de génocide à Gaza
Certains parlent de « génocide » à Gaza, mais cette accusation est fausse et trompeuse. Pour qu’il y ait génocide, il faut une intention d’exterminer un peuple entier et les moyens pour y parvenir.
Israël possède les moyens militaires de rayer Gaza de la carte, de faire disparaître totalement la bande de Gaza et de détruire la présence palestinienne sur ce territoire. Pourtant, il ne le fait pas, car son intention n’est pas d’exterminer le peuple palestinien. Historiquement, Israël a été favorable à une solution à deux États et à la cohabitation pacifique avec les Palestiniens. Même si les circonstances actuelles, notamment les attaques du Hamas et le 7 octobre 2023, rendent cette perspective très difficile, Israël reste attaché à la protection de civils innocents et à une solution qui ne conduirait pas à l’éradication d’un peuple entier.
À l’inverse, le Hamas avait l’intention de commettre un génocide contre les Israéliens lors du 7 octobre 2023, en ciblant exclusivement des civils. Cependant, ils n’en avaient pas les moyens militaires suffisants pour y parvenir.
Cette distinction fondamentale entre intention et moyens explique la différence entre les deux situations :
• Israël possède les moyens mais n’a pas l’intention → pas de génocide.
• Le Hamas a l’intention de commettre un génocide, mais n’en a pas les moyens. La preuve : ils revendiquent le rejet total d’Israël, jusqu’à vouloir « pousser les Juifs dans la mer ».
Le drame des civils et les réalités de la guerre
Cela ne veut pas dire qu’Israël agit dans un monde parfait. Les pertes civiles existent, et elles sont tragiques. Mais il faut avoir l’honnêteté de reconnaître que ces pertes ne sont pas le fruit d’un choix délibéré d’Israël : elles découlent du fait que les groupes terroristes utilisent délibérément leurs propres civils comme boucliers humains, installant leurs bases dans des écoles, des hôpitaux, des quartiers densément peuplés. On est face à une situation où, quoi qu’il fasse, Israël est accusé : s’il ne riposte pas, il laisse les terroristes libres de tuer. S’il riposte, il est accusé de “massacrer”. Mais dans une guerre contre le terrorisme, il n’existe pas de solution sans douleur.
Charlie Kirk : la droite, la foi chrétienne et le soutien inébranlable à Israël
Charlie Kirk était une figure emblématique de la droite américaine, connue pour sa fermeté et son engagement sans compromis. Il incarnait une droite qui refuse de céder face au terrorisme et qui soutient Israël comme démocratie alliée et rempart face à ceux qui cherchent la destruction par la violence. Kirk a exprimé publiquement à plusieurs reprises son attachement à Israël et aux droits bibliques de la terre. Lors d’un déplacement à Jérusalem en 2019, il déclarait : « Je suis très pro-Israël … j’ai défendu Israël toute ma vie », affirmant ainsi son soutien à un pays confronté au terrorisme et à des groupes qui utilisent les civils comme boucliers humains. Il rejetait également les accusations selon lesquelles Israël affamerait volontairement les Palestiniens, et critiquait les manifestations pro-palestiniennes sur les campus américains, les considérant souvent comme dépassant la liberté d’expression.
Mais Charlie Kirk ne se limitait pas à la politique : il était également chrétien évangélique, et plaçait sa foi en Jésus-Christ au centre de sa vie et de ses actions. Dès son enfance, il témoignait de son engagement spirituel, et tout au long de sa vie, il a assumé cette foi publiquement, avec courage et assurance. Dans un contexte souvent hostile, il défendait la vérité biblique, la vie, la famille et les valeurs chrétiennes avec une apologétique solide, capable de répondre aux critiques et de tenir tête à des militants ouvertement opposés à ses convictions.
Son engagement combiné envers la droite, Israël et sa foi chrétienne faisait de lui une voix rare et combative, qui ne transigeait ni sur le terrorisme, ni sur les principes fondamentaux de sa foi. Charlie Kirk montrait ainsi que la défense d’Israël et le témoignage chrétien ne sont pas seulement des choix politiques ou spirituels, mais des positions fermes, courageuses et cohérentes face à un monde qui tend trop souvent à banaliser la violence ou à édulcorer la foi.
Perspective eschatologique sur les nations et le jugement dernier
Les débats de notre époque – qu’ils soient politiques, idéologiques ou géopolitiques – trouvent leur véritable lumière dans le plan ultime de Dieu. Derrière les tensions humaines se profile une réalité spirituelle et prophétique que les Écritures ont annoncée.
Quand Jésus parle du jugement dernier, il place les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche (Matthieu 25:31-34). Ce n’est pas un hasard si la droite est associée à la bénédiction et la gauche au rejet : ce contraste illustre la séparation définitive entre ceux qui auront marché dans la vérité et ceux qui l’auront refusée.
Or, n’est-il pas frappant de constater que, dans nos débats politiques actuels, un clivage similaire apparaît ?
Une partie de la droite se place du côté d’Israël, reconnaissant, même imparfaitement, le rôle particulier de ce peuple dans l’histoire et les promesses de Dieu.
Tandis qu’une grande partie de la gauche s’aligne, consciemment ou inconsciemment, avec ceux qui s’opposent à Israël, allant parfois jusqu’à défendre des groupes qui emploient la terreur.
Bien sûr, aucun parti politique n’est parfaitement pur ni totalement du côté de Dieu. Mais ce parallèle résonne comme un signe prophétique : la droite et la gauche ne sont plus seulement des orientations politiques, elles deviennent l’ombre d’une division spirituelle bien plus profonde, celle que Jésus annoncera au dernier jour.
Le prophète Zacharie décrit Jérusalem comme une pierre lourde à soulever pour les nations : « Toutes les nations de la terre s’assembleront contre elle » (Zacharie 12:3). Et pourtant, au moment de l’épreuve, Dieu interviendra pour défendre son peuple, répandant « un esprit de grâce et de supplication » (Zacharie 12:10), tournant les regards vers « celui qu’ils ont transpercé ». Déjà se dessine ici l’annonce de la révélation de Jésus comme Messie, reconnu par Israël dans la douleur mais aussi dans l’espérance.
Puis, Zacharie poursuit : « Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat… alors l’Éternel sortira et combattra ces nations » (Zacharie 14:2-3). L’événement culmine avec le retour glorieux du Messie : « Ses pieds se placeront… sur le mont des Oliviers » (Zacharie 14:4). Ce moment n’est pas seulement une délivrance pour Israël, mais aussi une ouverture pour toutes les nations, car « tous ceux qui subsisteront… monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l’Éternel des armées » (Zacharie 14:16).
Enfin, Jésus lui-même a annoncé le jour où toutes les nations seraient rassemblées devant son trône : « Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs » (Matthieu 25:32). Ce jugement dernier mettra fin aux ambiguïtés, aux compromis et aux illusions des hommes. Ceux qui auront marché dans la lumière recevront cette parole du Roi : « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume préparé dès la création du monde » (Matthieu 25:34).
Ainsi, au-delà des querelles et des idéologies qui marquent notre temps, le plan de Dieu avance inexorablement vers son accomplissement. L’histoire humaine se dirige vers ce moment décisif où le Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, établira son règne de justice et de paix. Et chaque homme, chaque nation, sera confronté à cette vérité éternelle.
Face au terrorisme : agir ou devenir spectateur du chaos
Le clivage est simple et net :
• La droite condamne le terrorisme, défend Israël, et refuse de reconnaître comme État un territoire gouverné par des terroristes.
• La gauche relativise, victimise, et va jusqu’à récompenser le terrorisme par une reconnaissance politique.
Il ne s’agit pas seulement de diplomatie ou de géopolitique : c’est une question de survie morale. Soit nous tenons une ligne ferme et intransigeante contre le terrorisme, soit nous ouvrons la porte à son expansion jusqu’à ce qu’il s’impose comme une norme mondiale.
Accepter de légitimer des terroristes, c’est ouvrir la porte au règne de la barbarie.
Le choix est devant nous. Il ne s’agit pas seulement de politique : c’est une guerre spirituelle. À chacun de prendre position.
Luc Vandestraten